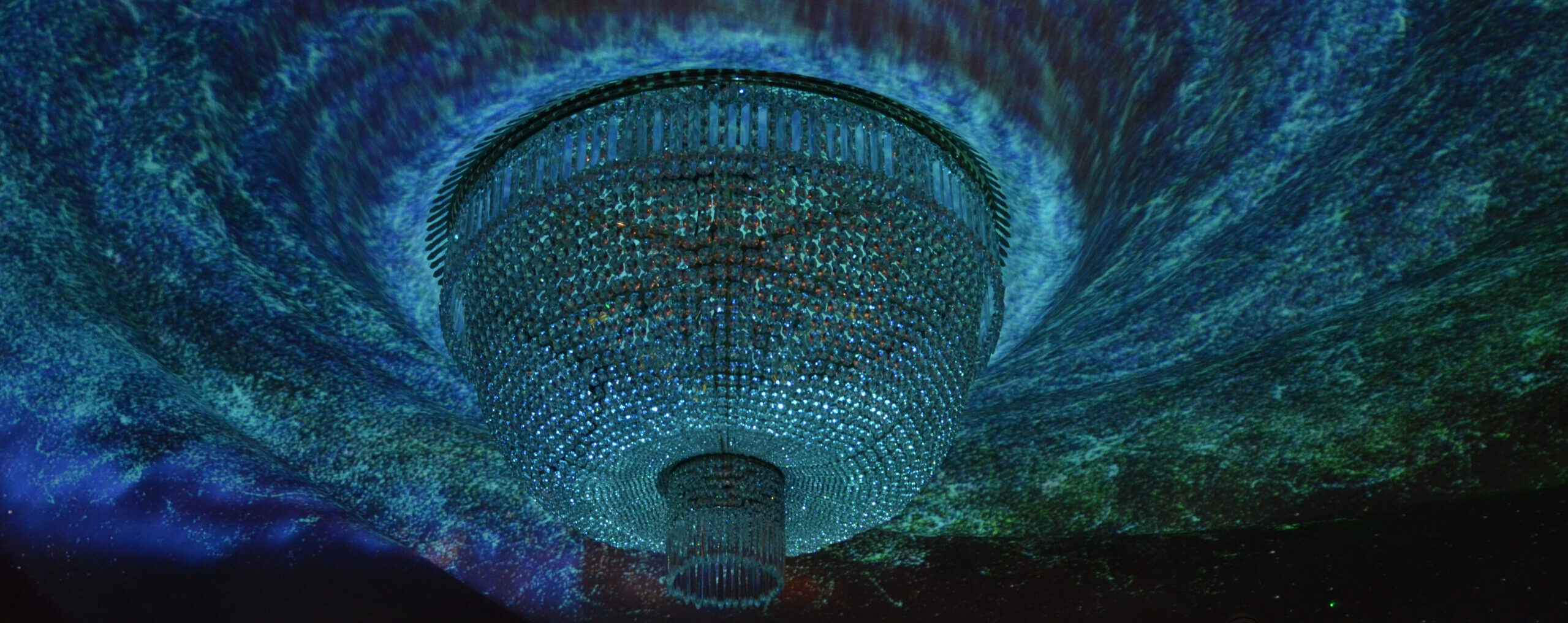Chapitre 16
Infiltrations (8 août 2009, 6h à Madère)
Rémi se réveilla avec difficulté. Il avait très mal dormi du fait de sa conversation de la veille avec Lambruscino. Il se redressa sur son séant, puis posé un pied à terre et décida qu’il était trop tard pour renoncer maintenant. Il se leva et s’habilla silencieusement, en se demandant depuis combien de temps il n’avait pas mis de vêtements vraiment propres et pliés. Il secoua cette idée saugrenue et se dirigea vers la cuisine.
Il y retrouva Lambruscino et deux soldats du groupe.
« On y va ? demanda Lambruscino de but en blanc.
-Veronica n’est pas là ? demanda Rémi avec un air déçu.
-Nous sommes tombés d’accord sur le fait qu’il était plus raisonnable qu’elle ne vienne pas vous souhaiter bonne chance ce matin, » répondit Lambruscino.
Rémi foudroya Lambruscino du regard mais n’osa rien dire devant les deux soldats.
Les deux frères sortirent de la maison quelques instants plus tard, repus après un frugal petit déjeuner. Le soleil commençait à se lever à l’horizon et à projet sa douce chaleur.
Ils sortirent de la propriété et se dirigèrent vers la mairie de Funchal, là où ils pensaient avoir le plus de chance de trouver Marcovi. Les décors qu’ils traversaient étaient lugubres, des cadavres jonchaient le sol à certains endroits et commençaient à pourrir, et de temps en temps, on entendait des cris et des coups de feu au loin, puis un lourd silence retombait sur cette ville qui était maintenant presque fantôme.
Ils arrivèrent à la mairie une demi-heure plus tard et se rendirent comme prisonniers au soldat en faction. Celui-ci se demanda d’abord ce qui lui arrivait et les regarda d’un air surpris, puis ordonna à d’autres soldats de les emmener, faut de meilleure réaction possible. Lambruscino précisa au soldat qu’il voulait parler à Marcovi le plus rapidement possible, et donna leurs noms, sachant la réaction qu’aurait le dictateur en les entendant.
Les soldats les emmenèrent dans une salle sombre sans fenêtre de la mairie, fermèrent la porte à clé, et les informèrent qu’ils allaient parler à Rui Marcovi.
Rui Marcovi n’en croyait pas ses oreilles. Et pourtant le soldat en face de lui semblait le plus sérieux du monde. Ainsi Carlier et Lambruscino s’étaient rendus et voulaient coopérer ? Cela sentait le piège à plein nez. Mais en même temps, les deux hommes n’avaient aucun moyen de le piéger : ils étaient sur son île tenue par ses mercenaires qu’il payait plus que grassement.
Marcovi avait d’ailleurs fait ses calculs : au vu de la valeur du trésor, du nombre de mercenaires qu’il avait sous ses ordres et du prix qu’il les payait, il pouvait encore maintenir son gouvernement pendant 70 ans. Bien assez pour aller jusqu’à la fin de sa vie donc.
Marcovi redirigea ses pensées vers Carlier et Lambruscino. Il voulait les confronter et éventuellement déjouer le piège qui lui serait tendu, si tant est qu’il y en avait un. De plus, il n’avait rien à perdre à aller leur parler.
Il se dirigea vers la porte et demanda à être conduit à la mairie.
Il y arriva un quart d’heure plus tard et ordonna au garde de le conduire rapidement à Carlier et Lambruscino. Il fut introduit dans leur cellule, et le garde resta derrière lui au cas où la situation dégénèrerait.
« Eh bien messieurs, comme on se retrouve, s’excelama-t-il. Et quel plaisir de vous retrouver ! J’ai entendu dire que vous vouliez me parler. »
Carlier et Lambruscino s’efforcèrent de prendre un air gêné. Puis au bout de quelques secondes qui semblèrent une éternité à Marcovi, Lambruscino prit la parole sur un ton hésitant magnifiquement imité.
« Monsieur Marcovi, commença-t-il, je ne sais pas comment vous expliquer ça…
-Je n’ai pas toute la journée devant moi, monsieur Lambruscino, alors dépêchez-vous un peu ou vous aurez tout le restant de votre vie pour réfléchir à votre phrase dans cette cellule !
-Eh bien voilà, répondit Lambruscino, sentant l’urgence de formuler intelligiblement son propos, nous avons fait une erreur. Nous avons refusé votre offre, puis nous nous sommes évadés de notre cellule car nous pensions avoir des principes. Puis un groupe de résistants nous a recueillis. Au début, nous étions prêts à les aider pour des petites choses, mais rapidement, ils nous ont demandé de faire des attentats, de tuer des hommes, sous peine de nous tuer, nous. Nous avons vite fait le calcule : travailler avec des soi-disant résistants et être menacés de mort chaque jour, ou bien avoir une vie dorée du côté gagnant : il ne nous a pas fallu longtemps pour nous décider. Comme vous le savez, comme chacun sait d’ailleurs, j’ai une très forte attirance pour tout ce qui brille, donc travailler pour une dictature et m’enrichir ne me pose pas de problème. Cela en posait à mon ami monsieur Carlier, mais l’appât du gain et l’aspect sécuritaire ont eu raison de lui. Nous venons donc nous mettre à votre service, monsieur Marcovi. Nous avons en guise de cadeau d’excuse et de preuve de notre bonne foi des informations sur le groupe de résistants que nous avons infiltré. Il nous reste un contact au sein de ce groupe, qui nous communique les informations donc nous avons besoin au fur et à mesure, et pour lequel nous vous demanderons l’immunité également. Voilà donc pourquoi nous sommes là et ce que nous avons à offrir, monsieur Marcovi : nous, et l’élimination du plus gros groupe de résistance de l’île. »
Après cette longue tirade, il y eut un grand silence durant lequel Marcovi regardait tour à tour les deux hommes, tentant de les jauger. Il s’était toujours targué d’être un très bon juge de caractère. Déjà dans sa jeunesse, cela lui permettait de voir les gens qui feraient des choses pour lui. Mais là l’enjeu était autre. Au bout d’un moment, il jugea qu’ils avaient l’air sincères. De plus, qu’avait-il à perdre en prenant leurs informations, sachant qu’il pourrait toujours les sacrifier après ? Marcovi décida donc de tenter le coup.
« Bien, dit-il, j’accepte. Vous ferez partie de mon comité de direction de l’île. Mais je veux que ce soir, quelques résistants soient sous les verrous. Sinon je vous ferai exécuter.
-Cela me paraît une proposition tout à fait honnête, » dit Lambruscino.
Marcovi lui tendit la main et Lambruscino la serra. Puis Marcovi se tourna vers Calier et celui-ci accepta la poignée de main à son tour. En touchant la main de ce terroriste, il faillit avoir un haut-le-cœur, mais il se retint et maintint son regard franc et ferme.
« Suivez-moi, » dit Marcovi en les emmenant hors de la cellule.
« Que fait la police ?
Un reportage de Mathieu Gentil
8 août 2009
Hier dans la journée, le gouvernement Portugais avait nommé le commissaire Jacques Leroi comme directeur d’une cellule de crise spéciale visant à régler définitivement et sans trop de dommage la crise actuelle se déroulant à Madère. Ce commissaire avait en effet demandé à parler au gouvernement et à l’armée, et leur avait exposé ce qu’il avait qualifié d’une « bonne » idée. Mais comme chacun sait, une bonne idée mal exécutée peut en devenir une mauvaise. En effet, le piège que le commissaire Leroi voulait tendre à Rui Marcovi était tellement gros que celu-ci a refusé toute négociation et a même formulé de nouvelles demandes, encore plus rudes que les précédentes.
Suite à cela, le commissaire Leroi s’est fait évincer de la cellule de crise et est actuellement interrogé par les autorités Portugaises qui commencent à avoir des doutes sur son intégrité.
En tant que Français et patriote, je ne peux que m’alarmer du fait que de tels hommes donnent une image aussi déplorable de mon pays, surtout dans une période aussi critique. En effet, à cause de cet événement, les relations entre la France et le Portugal vont se tendre et se compliquer, et tout cela par la faute d’un seule homme.
J’ai honte d’être Français aujourd’hui, et je prie pour les familles des Français prisonniers à Madère, à qui l’espoir de retrouver les leurs a été quasiment éteint suite à cet événement grotesque.
L’Europe n’aura plus jamais le même visage après cette crise, et à l’heure où je vous écris, le gouvernement Français redouble de diplomatie pour regagner les faveurs du Portugal, mais il y a fort à parier que Lisbonne demandera dans les prochains jours à Paris de quitter l’Union Européenne, ce qui aurait des conséquences politiques et économiques désastreuses pour nous.
Fort heureusement, nous n’en sommes pas encore là, mais la bêtise de ce commissaire pourrait bien nous y mener rapidement. »
Rui Marcovi emmena Marc Lambruscino et Rémi Carlier dans une immense bâtisse en pierre blanche qui avait été auparavant le commissariat principal de Funchal. La devanture était parsemée d’impacts de balles, conséquence des événements des jours précédents, et il restait encore quelques traces de sang sur le sol devant l’entrée.
Un soldat armé suivait les trois hommes de près, preuve que Marcovi n’avait pas encore accordé toute sa confiance aux deux Français. Le petit groupe entra dans un gigantesque hall recouvert de dalles de marbre beige, et au bout duquel se dressait un escalier majestueux. Ils l’empruntèrent et se retrouvèrent devant un long couloir sur lequel donnaient de nombreuses portes fermées. Marvoci se dirigea vers la première à sa droite.
La porte s’ouvrit sur une salle étroite remplie de matériel électronique, et au milieu de laquelle trônait un téléphone fixe noir, datant visiblement des années 1980. Quatre gardes entouraient ce téléphone dont la valeur intrinsèque n’était pas si grande que cela, tandis que deux autres hommes avaient chacun les yeux rivé sur un écran d’ordinateur.
« Voici, dit Marcovi, le seul téléphone de Madère. Bien entendu, lorsque nous recevons des appels de l’extérieur, ceux-ci peuvent être transférés vers le téléphone de ma résidence. Mais on ne peut passer des appels vers l’extérieur que depuis ce poste. Nous avons désactivé tous les réseaux de téléphone portable, de radio, Internet et 3G. »
Marcovi désigna les deux ordinateurs de la pièce.
« Et voici les deux seuls ordinateurs à Madère à être encore connectés à Internet. J’y maintiens deux hommes 24h/24, un pour me tenir informé des grandes nouvelles dans le monde et en particulier sur Madère, et l’autre pour vérifier que personne ne pirate notre système. Cette possibilité est peu probable, mais je préfère ne pas prendre de risque. Une révolte avec un soutien extérieur serait trop difficile, voir impossible à gérer. D’ailleurs cecit devrait vous intéresser messieurs. »
Marcovi leur tendit un papier, duquel Lambruscino s’empara et que Carlier lut par-dessus l’épaule de son frère. Il s’agissait de l’article de Mathieu Gentil s’acharnant sur Jacques Leroi. Carlier étouffa un cri. Il ne supportait pas de voir son ami et mentor traîné ainsi dans la boue, mais il ne pouvait rien dire sans risquer de se décrédibiliser auprèes de Marcovi. Lambruscino resta de marbre de son côté.
« Quels incapables ces Français, dit Lambruscino d’un ton dur lorsqu’il eut fini de lire. Ils vous prennent pour un petit dictateur de pacotille et pensent vous manipuler à coup de petites tactiques de bas étage, c’est révoltant. Je vous félicite d’ailleurs de ne pas vous être laissé embobiner.
-Merci, dit Marcovi flatté, mais le piège était vraiment gros comme vous l’avez si bien dit. »
Carlier n’arrivait pas à lâcher la feuille des yeux, mais il se rappela la recommandation que Lambruscino lui avait faite : quoiqu’il arrive, ne pas faillir à la mission, ne rien lâcher, ne rien laisser paraître. Les enjeux étaient trop grands. Il releva donc la tête et se fit violence pour arborer un fier sourire, montrant son accord avec les propos de Lambruscino.
Marcovi sembla convaincu de la composition de Carlier et emmena les deux hommes vers une autre salle, plus éloignée sur la gauche de ce long couloir. Il l’ouvrit et Carlier et Lambruscino virent s’étaler devant eux une véritable salle d’état-major, où de nombreuses cartes étaient disposées, avec une plus grande que les autres qui s’étalait sur une large table au centre de la pièce. Des soldats étaient amassés autour et y plantaient des épingles rouges et noires.
« Voyez-vous, dit Marcovi, c’est ici que nous gérons la lutte contre la résistance. Nous avons des sources qui nous permettent d’identifier les lieux présumés où se cachent les nids de résistance. Nous mettons à ce moment-là une épingle rouge sur cette carte de Madère, et lorsque l’endroit est nettoyé, nous en mettons une noire pour garder l’endroit en mémoire. Evidemment suit une saisie informatique avec les rapports de bataille pour chaque éradication, pour les archives de l’état Madérien. »
Les archives de l’état Madérien, pensa Carlier, eh bien il ne perd pas de temps à s’organiser lui, il faut garder cela en tête.
Carlier eut un pincement au cœur en voyant toutes les épingles noires sur la carte de détail de Funchal, et pensa à tous ces hommes qui avaient donné leur vie pour reprendre leur liberté. Il devait faire cesser cela. Le plan devait marcher.
Marcovi continuait à exposer son organisation pendant ce temps.
« Notre plus grand ennemi restant actuellement est le Comité de Révolte, je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
-C’est précisément celui que nous avons infiltré, répondit Lambruscino.
-Vous plaisantez ? »
Marvoci semblait tout d’un coup très intéressé par ce que lui disait Lambruscino. Le poisson était ferré, il ne restait plus qu’à refermer l’étau.
« Eh oui, dit Lambruscino, et voici la première information que nous avons à vous donner : ils se cachent dans la maison de mademoiselle Veronica Siretti, à Funchal, dont vous avez assassiné le père. C’est elle qui mène ce mouvement de résistance maintenant. Très belle, mais mortelle. »
Marcovi se frotta les mains et aboya un ordre en Portugais aux soldats. Ceux-ci sortirent précipitamment de la pièce.
« Nous allons maintenant voir ce que valait votre renseignement, dit Marcovi. Si nous voyons que vous ne nous avez pas trompés, ce sera bienvenue dans la grande famille ! Sinon ce sera une balle dans la tête sans sommation à chacun. Je me suis bien fait comprendre ?
-C’est limpide, dit Carlier.
-Vous verrez que nous avons raison, dit Lambruscino. Par contre, vous feriez mieux de faire vite, car ils ont dû s’apercevoir que nous nous étions échappés. Ils vont donc sûrement fuir l’endroit le plus vite possible. Agissez rapidement, je vous en conjure.
-J’en suis conscient, dit Marcovi, c’est pourquoi j’ai dit à mes hommes de faire vite. Mais vous avez également parlé d’une source que vous avez.
-Oui, dit Lambruscino, c’est exact.
-Quant et comment êtes-vous censé la rencontrer ?
-Ce soir, sur la plage de Funchal. Seul, bien évidemment.
-Je comprends. De toute façon je garderai monsieur Carlier ici présent en otage. Comme je suis sûr que vous n’abandonnerez pas votre frère, je suis serein. »
Carlier resta bouche bée.
« Comment savez-vous cela ? demanda-t-il ?
-Nous avons fouillé l’appartement de Monsieur Lambruscino, et nous avons trouvé tous les documents prouvant cela. Comme cela, si vous nous trahissez, non seulement je vous tuerai, mais je ruinerai vos réputations et celles de vos familles. C’est très mal vu pour un policier d’être le frère d’un criminel, et vice-versa également je pense.
Lambruscino hocha doucement la tête en signe de compréhension, et Carlier fit de même. Marcovi les regarda intensément puis, satisfait, sourit largement.
« En attendant, je vous invite à prendre l’apéritif avec moi messieurs ! »
Sur ces mots, il les emmena hors de la pièce.
Il était midi et le soleil chauffait les rues silencieuses de Funchal. La maison de Veronica Siretti était calme, et il semblait n’y avoir personne à l’intérieur. Pourtant, en observant plus attentivement, on pouvait distinguer ce qui ressemblait à l’ombre d’un visage d’un homme derrière le rideau d’une fenêtre du 2ième étage.
Cela n’échappa pas à Mario, le chef du petit escadron de mercenaires qui observait la maison depuis un moment déjà.
Le départ de Lambruscino et Carlier avait dû mettre les résistants en état d’alerte, et ils s’attendaient vraisemblablement à une attaque de mercenaires. Si ceux-ci voulaient pouvoir minimiser les pertes et faire le plus de prisonniers résistants possible, ils avaient intérêt à se montrer subtils. C’est pourquoi Mario réfléchissait à un plan d’attaque le plus intelligent possible, mais il ne voyait rien. Il disposait de quatorze hommes armés chacun de fusils d’assaut et de révolvers d’appoint. Mario estimait que les résistants devaient avoir le même genre d’armes, car ils les avaient sûrement dérobées à des mercenaires morts ou prisonniers. Le problème était que Mario ne savait pas combien d’hommes se trouvaient dans la bâtisse.
Il envoya donc un de ses hommes escalader le mur de la maison voisine discrètement pour aller observer le côté jardin de la maison Siretti. Le jeune homme, un certain Antonio, passa facilement au-dessus du mur, contourna la maison voisine, se percha sur le mur séparant les deux maisons et commença à regarder du côté de chez Siretti.
Mario entendit une détonation et vit le jeune homme tomber du mur, mort d’una balle dans la tête. Tant pis pour la subtilité, se dit-il.
« En avant, » cria-t-il en Portugais.
Les treize hommes qui lui restaient le suivirent en courant. Arrivés à une cinquantaine de mètres de la maison, des détonations retentirent aux oreilles des mercenaires, et Mario vit quelques hommes de son bataillon tomber raide morts. Les vivants ne s’arrêtèrent pas pour autant, et furent même encouragés à redoubler de vitesse.
Finalement, ils furent neuf à arriver à la porte d’entrée, qu’ils n’eurent aucun mal à ouvrir car elle n’était pas fermée à clef. Les mercenaires entrèrent donc rapidement, et ne trouvèrent pas de résistances au rez-de-chaussée. Les habitants de la maison étaient visiblement dans les étages. Les mercenaires se dirigèrent donc vers la cage d’escalier et attendirent les ordres.
Mario risqua un pas dans la cage, et lança une grenade vers le premier étage. Lorsque celle-ci explosa, les neuf hommes s’engouffrèrent dans les escaliers en profitant de la fumée et de la confusion créée par cette explosion.
Ils arrivèrent au premier étage où ils trouvèrent deux cadavres de résistants et un homme blessé à la jambe droite. Ce dernier leva les bras en signe de soumission en voyant les mercenaires. Un des neuf hommes resta avec lui et les huit autres inspectèrent toutes les pièces de l’étage, où ils ne trouvèrent personne d’autre. Ils se dirigèrent donc vers la deuxième partie de l’escalier où Mario appliqua la même tactique qu’il avait mise en place pour le premier étage. Lui et ses hommes arrivèrent donc sans dommage au deuxième étage, mais ils ne virent personne. Ils inspectèrent donc les pièces une à une. Lorsque vit la dernière porte, ils retinrent leur souffle, l’ouvrirent, mais il n’y avait plus personne. Où était donc l’homme qu’ils avaient vu à la fenêtre ? Marcio constata qu’une des fenêtres de l’étage était entrouverte. Il courut vers elle et vit un homme qui s’échappait par le jardin. Ainsi il était descendu le long du mur pendant que la bataille faisait rage à l’intérieur. Mario épaula donc son fusil, visa soigneusement, et tira. L’homme s’effondra instantanément, la balle l’avait touché à la tête. Aucun doute possible sur le fait qu’il était mort.
Mario se tourna vers ses hommes.
« Je vous félicite, dit-il, nous avons là un prisonnier que nous allons pouvoir faire parler. Ramenons-le à Rui Marcovi, il nous récompensera bien pour ça ! »
Marc Lambruscino était sur le balcon de la résidence de Marcovi. Celui-ci avait offert une suite aux deux Français pour les féliciter de la fiabilité de leurs renseignement. Il avait donc mordu à l’hameçon visiblement. Il s’agissait maintenant de capitaliser sur cet acquis et de progresser dans ses faveurs pour accéder au plus vite à la localisation du trésor. Lambruscino avait convenu avec Veronica de rencontrer un des hommes du Comité de Révolte pour qu’il lui donne les informations à transmettre à Marcovi. Le rôle qu’il devait jouer lui plaisait de moins en moins, car il menait la belle vie pendant que d’autres souffraient ou mouraient. De plus, il avait peur perdre de vue son objectif final au milieu de ce faste, et surtout de ce double jeu que l’on lui faisait jouer.
Mais il savait que ce rôle était fondamental pour renverser Marcovi, et que Rémi avait l’air de tenir le sien correctement, même si l’affaire Leroi l’avait fortement ébranlé, vu que cet homme était son ami et mentor depuis des années. Mais Lambruscino savait qu’il ne pouvait pas réconforter son frère sur le sujet, car il se doutait que Marcovi avait mis des micros et des caméras de surveillance dans leurs suites, et que par conséquent aucun sujet délicat ne pouvait être abordé. Du coup aucun sujet n’était globalement abordé car les deux hommes ne se parlaient pas tellement la tension de leur position était forte.
Carlier était allé se coucher quelques instants plus tôt, alors que Lambruscino ne se sentait pas fatigué. Il était donc sorti sur la terrasse et contemplait le spectacle qui s’offrait à ses yeux, et qui n’avait rien à voir avec celui qu’il avait découvert en arrivant à Funchal. Lorsqu’il avait atterri dans cette ville, il avait été frappé par sa beauté, par les sourires des habitants, par le brouhaha joyeux de la rue, et les marchés animés. Mais maintenant la vie était blessée, abîmée et ne s’en relèverait peut-être jamais. Beaucoup de bâtisses avaient été démolies, les rues étaient vides et tristes, et de temps en temps le silence était brisé par un coup de feu qui retentissait au loin, résultat d’escarmouches entre résistants et mercenaires. La ville et l’île étaient devenues tristes. Lambruscino songea qu’il était temps d’arrêter cette folie et rendre aux madériens leur liberté.
Lambruscino regarda l’heure, il était 16h, encore 4 heures avant son rendez-vous. Il soupira et se tourna vers le mini-bar. Il prit un verre de scotch qu’il vida d’un trait. L’alcool fort réveilla son optimisme et un léger sourire apparut sur les lèvres de Lambruscino. Il fallait qu’ils gagnent, et ils allaient gagner.
Il était 18h. Le pétrolier « La Felouca » arriva au Détroit de Gibraltar. Il était parti le jour même de Porto et avait caboté jusqu’au détroit, avait de s’apprêter à le dépasser pour longer les côtes africaines. Il était prévu que le pétrolier se dirige ensuite vers la pleine mer pour atteindre Rio de Janeiro, au Brésil. Cela devait être le dernier voyage de ce pétrolier, avant son démantèlement, et le dernier de son capitaine avant sa retraite.
Celui-ci craignait des problèmes avec la veille machine en pleine mer, mais il avait la liste des îles où il pouvait faire escale en cas de problème en chemin. Le capitaine attrapa l’interphone :
« Messieurs, direction plein Ouest. »